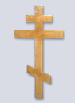Depuis l’époque paléochrétienne, chaque année à l’approche de Pâques, les chrétiens se préparent à vivre la fête de la résurrection du Christ. Bien des manières de se préparer pourraient être considérées comme orthodoxes au sens fort du terme. Toutefois, dans la réalité actuelle, l’orthodoxie est surtout de tradition byzantine, du point de vue cultuel et culturel. Notre courte présentation se restreindra donc à cette expérience. Présentation de Christophe D’Aloisio.
Depuis l’époque paléochrétienne, chaque année à l’approche de Pâques, les chrétiens se préparent à vivre la fête de la résurrection du Christ. Bien des manières de se préparer pourraient être considérées comme orthodoxes au sens fort du terme. Toutefois, dans la réalité actuelle, l’orthodoxie est surtout de tradition byzantine, du point de vue cultuel et culturel. Notre courte présentation se restreindra donc à cette expérience. Présentation de Christophe D’Aloisio.
Le carême dans l’Eglise orthodoxe
Présupposés ecclésiologiques
 Pour bien présenter le carême dans la tradition orthodoxe, il peut être utile, par souci d’éviter tout confessionnalisme, de commencer par quelques précisions sur l’Église elle-même, dans la conception orthodoxe. La théologie orthodoxe – comme celle de toute Église chrétienne – ne conçoit l’existence que d’une seule Église du Christ, manifestée dans chaque Église locale, catholique. Dans le cadre religieux chrétien, le mot signifie selon le tout, universel. Il désigne à la fois la volonté de confesser la foi formulée dans le credo ou symbole des apôtres sans refuser aucun article. Il s’oppose à l’hérésie qui fait un choix, un tri, et ne conserve pas l’unité organique de la foi chrétienne et son universalité. Les mots catholique et catholicisme désigneront par la suite la seule Église catholique romaine (au sens premier du mot). Dans l’histoire, l’unique Église du Christ a connu et connaît encore des divisions. De ce fait, une question surgit inévitablement : quelle Église est l’Église ? Une autre question suit en conséquence : où sont les limites de l’Église ? Il serait réducteur de dire que telle Église est l’Église du Christ, les autres n’étant que des éclats, séparés du tronc de la vraie Vigne. C’est une position fondamentaliste, que l’on peut trouver mutatis mutandis (cette expression signifie ici les changements nécessaires ayant été faits pour rendre les comparaisons possibles dans chacune des familles chrétiennes). Nous opterons, quant à nous, pour une position de dialogue ; nous croyons que l’unique Église du Christ se manifeste de manière plus ou moins plénière dans toute communauté qui invoque le nom du Seigneur Jésus, le Fils unique et Verbe de Dieu, incarné dans le sein de la Vierge Marie par l’opération de l’Esprit saint. L’orthodoxie est une des formes que prend le christianisme dans l’histoire. Bien que présente en Occident de manière minoritaire depuis un peu plus d’un siècle, l’Église orthodoxe d’aujourd’hui plonge ses racines essentiellement dans l’Orient chrétien. Depuis l’époque paléochrétienne, chaque année à l’approche de Pâques, les chrétiens se préparent à vivre la fête de la résurrection du Christ. Bien des manières de se préparer pourraient être considérées comme orthodoxes au sens fort du terme. Toutefois, dans la réalité actuelle, l’orthodoxie est surtout de tradition byzantine, du point de vue cultuel et culturel. Notre courte présentation se restreindra donc à cette expérience.
Pour bien présenter le carême dans la tradition orthodoxe, il peut être utile, par souci d’éviter tout confessionnalisme, de commencer par quelques précisions sur l’Église elle-même, dans la conception orthodoxe. La théologie orthodoxe – comme celle de toute Église chrétienne – ne conçoit l’existence que d’une seule Église du Christ, manifestée dans chaque Église locale, catholique. Dans le cadre religieux chrétien, le mot signifie selon le tout, universel. Il désigne à la fois la volonté de confesser la foi formulée dans le credo ou symbole des apôtres sans refuser aucun article. Il s’oppose à l’hérésie qui fait un choix, un tri, et ne conserve pas l’unité organique de la foi chrétienne et son universalité. Les mots catholique et catholicisme désigneront par la suite la seule Église catholique romaine (au sens premier du mot). Dans l’histoire, l’unique Église du Christ a connu et connaît encore des divisions. De ce fait, une question surgit inévitablement : quelle Église est l’Église ? Une autre question suit en conséquence : où sont les limites de l’Église ? Il serait réducteur de dire que telle Église est l’Église du Christ, les autres n’étant que des éclats, séparés du tronc de la vraie Vigne. C’est une position fondamentaliste, que l’on peut trouver mutatis mutandis (cette expression signifie ici les changements nécessaires ayant été faits pour rendre les comparaisons possibles dans chacune des familles chrétiennes). Nous opterons, quant à nous, pour une position de dialogue ; nous croyons que l’unique Église du Christ se manifeste de manière plus ou moins plénière dans toute communauté qui invoque le nom du Seigneur Jésus, le Fils unique et Verbe de Dieu, incarné dans le sein de la Vierge Marie par l’opération de l’Esprit saint. L’orthodoxie est une des formes que prend le christianisme dans l’histoire. Bien que présente en Occident de manière minoritaire depuis un peu plus d’un siècle, l’Église orthodoxe d’aujourd’hui plonge ses racines essentiellement dans l’Orient chrétien. Depuis l’époque paléochrétienne, chaque année à l’approche de Pâques, les chrétiens se préparent à vivre la fête de la résurrection du Christ. Bien des manières de se préparer pourraient être considérées comme orthodoxes au sens fort du terme. Toutefois, dans la réalité actuelle, l’orthodoxie est surtout de tradition byzantine, du point de vue cultuel et culturel. Notre courte présentation se restreindra donc à cette expérience.
Le pré-carême
La période de préparation à Pâques comporte trois phases, correspondant à trois séries de moments liturgiques : le pré carême, le carême proprement dit et la grande et sainte semaine.
Ces moments liturgiques sont célébrés par l’assemblée ecclésiale sur la base d’un livre liturgique contenant les offices de cette période, le triode. Dans la pratique courante, le mot triode peut désigner soit le livre, soit l’ensemble de ces trois périodes. Nous insisterons davantage sur la deuxième de ces trois phases, mais présenterons néanmoins les deux autres brièvement.
Le pré-carême commence par le dimanche du Publicain et du Pharisien. La lecture évangélique de ce jour correspond à cette parabole (Lc 18,10-14) et cherche à inspirer aux fidèles l’humilité devant Dieu et les hommes. Les dimanches qui suivront seront dédiés successivement à la parabole du Fils prodigue (Lc 15,11-32), au jugement dernier (Mt 25,31-46) et enfin au pardon (Mt 6,14-21). Ces deux derniers dimanches sont aussi appelés, respectivement, le dimanche de carnaval. À partir de ce dimanche, la tradition veut que l’on s’abstienne de manger de la viande (carn-, racine latine pour la chair ou la viande). Pour une explication du sens du jeûne. On commémore aussi ce jour-là la chute de l’homme, car si le Fils de Dieu devient Fils de l’homme, c’est pour assumer l’humanité et relever, avec Adam, tout le genre humain déchu. En faisant mémoire de cette tragédie cosmique de l’échec des premiers humains, nous affirmons notre consubstantialité avec eux ; leur histoire est la nôtre, chaque homme et chaque femme se retrouve en Adam, chacun est ensuite appelé à s’incorporer au nouvel Adam, Jésus Christ (cf. Rm 5,14-21) ou encore dimanche des laitages.
À partir de ce jour, commence le grand carême proprement dit, lors duquel de nombreux orthodoxes ne mangent pas de produit d’origine animale (lait, œufs, poissons…).
Le saint et grand carême
Le soir du dimanche des laitages, centré sur le thème du pardon, les fidèles sont invités à se réconcilier les uns avec les autres, conformément à la lecture évangélique du matin. Un moment liturgique peut être organisé à cet effet, aux vêpres du dimanche, mais il est aussi fréquent que les fidèles, dans une démarche personnelle, rencontrent celles et ceux avec qui ils ont un différend et tentent de se réconcilier avec eux (cf. Mt 5,23-24). Il est évident qu’une telle disposition au pardon et à la réconciliation devrait être quotidienne chez le chrétien, mais le cycle liturgique permet de réaffirmer cette disposition de manière régulière, au moins tous les ans. Fondamentalement, l’éthique ecclésiale est ascèse, tout prescription morale lui est étrangère.
Une fois le carême initié, les fidèles qui ont essayé de purifier leur cœur par le pardon, tenteront de maintenir un rythme ascétique soutenu pendant la première semaine du carême, jusqu’au dimanche suivant, appelé premier dimanche. Cette fête commémore la restauration de la vénération des icônes, le dimanche 11 mars 843, sous l’impératrice romaine d’Orient Théodora. Le nom de triomphe de l’orthodoxie qui peut paraître pompeux signifie que pour l’Église, le rétablissement de la foi est un triomphe sur l’hérésie christologique des destructeurs d’images saintes, du jeûne ou dimanche de l’orthodoxie. Pendant cette semaine, l’office pénitentiel des grandes complies est souvent célébré dans les monastères et les paroisses. On y lit par extraits un long poème sotériologique appelé « grand canon » écrit par saint André de Crète. Dans les familles, cette première semaine de carême peut être vécue aussi intensément que la Semaine sainte.
La grande et sainte semaine
Le carême prend fin le soir du vendredi avant le Vendredi saint. Le lendemain de ce jour, l’Église commémore le miracle de la résurrection de Lazare, Jn 11,1-45, l’ami du Christ. Le lendemain du samedi de Lazare, vient l’entrée à Jérusalem, Jn 12,1-18, comptée parmi les douze grandes fêtes de l’année liturgique. C’est l’accomplissement de la course de Jésus, la fin de son ministère, la reconnaissance de la royauté de Jésus par la bouche des tout-petits et des nourrissons (cf. Ps 8,3), l’entrée triomphale et humble à la fois du Messie dans la ville sainte (cf. Za 9,9).
Les jours qui suivent sont spécialement ceux de la Passion, ceux de la prédication de Jésus à Jérusalem, ceux de la trahison du Fils de l’homme. Les lectures bibliques de la Semaine sainte sont très riches. Nous donnons ci-dessous uniquement les lectures évangéliques des différents jours, omettant les lectures vétérotestamentaires ou les épîtres apostoliques : lundi : Mt 21,18-43 et Mt 24,3-35 ; mardi : Mt 22,15-23,39 et Mt 24,36-26,2 ; mercredi : Jn 12,17-50 et Mt 26,6-16 ; jeudi : Lc 22,1-39 ; Mt 26,1-20 ; Jn 13,3-17 ; Mt 26,21-39 ; Lc 22,43-45 ; Mt 26,40-27,2 ; Jn 13,1-11 et Jn 13,12-17 ; vendredi : Jn 13,31-18,1 ; Jn 18,1-28 ; Mt 26,57-75 ; Jn 18,28-19,16 ; Mt 27,3-32 ; Mc 15,16-32 ; Mt 27,33-54 ; Lc 23,32-49 ; Jn 19,25-37 ; Mc 15,43-47 ; Jn 19,38-42 ; Mt 27,62-66 ; Mt 27,1-56 ; Mc 15,16-41 ; Lc 23,32-49 ; Jn 18,28-19,37 ; Mt 27,1-38 ; Lc 23,39-43 ; Mt 27,39-54 ; Jn 19,31-37 ; Mt 27,55-61 ; samedi : Mt 27,62-66 ; Mt 28,1-20 ; dimanche de Pâques : Jn 1,1-17 ; Jn 20,19-25. Ces passages sont lus pendant les vêpres, les matines ou l’office des heures. D’autres lectures bibliques sont faites à partir des autres livres tant du Nouveau que de l’Ancien Testament.
Carême et Écriture
Le carême et la Semaine sainte sont des moments privilégiés de méditation de la Parole de Dieu. La Bible est abondamment lue, à l’office comme à la maison. Pendant le carême, outre les lectures habituelles de l’Apôtre (un extrait d’une épître du Nouveau Testament) et de l’Évangile, on lit intégralement le livre de la Genèse et celui des Proverbes. Au début de la Semaine sainte, on lit intégralement l’Exode, Job et les quatre évangiles. Chaque fidèle, selon ses possibilités et sa disponibilité, en général sur le conseil d’un père spirituel. La paternité spirituelle revêt une importance particulière dans l’Orient chrétien. Le père spirituel peut-être laïc ou membre du clergé, homme ou femme. Le fidèle le choisit pour sa sagesse et son expérience ; il lui confie ses péchés, ses doutes, ses joies et bénéficie en retour d’un soutien moral et paternel, lit également en privé des extraits de l’Écriture et des ouvrages de maîtres spirituels ayant brillé dans l’ascèse. L’expérience des Pères (et Mères) ascètes est considérée comme une mise en pratique, une incarnation, une image vivante de la sainte Parole de Dieu.
L’abstinence – totale ou partielle, selon les moments – de nourriture est une pratique religieuse aussi vieille que le monde : Adam, déjà, était invité au jeûne et a désobéi ; le jeûne était un élément important de la vie du peuple d’Israël. Le nouvel Israël a hérité de cette pratique : pendant les temps d’attente de l’Époux ; Cf. Mt 9,14-17 ; Mc 2,18-22 ; Lc 5,33-39 qu’est le Christ, l’Église se met à jeûner, en particulier pendant le carême, dans l’attente de la Résurrection.
Selon la tradition patristique, l’expérience des Pères et Mères dans la foi, le jeûne est une forme de tempérance qui atténue les passions. Il ne peut se concevoir qu’en conjugaison avec une certaine disposition du cœur : on ne jeûne pas qu’avec le corps, mais aussi avec l’esprit. Is 58,6-12.
Tous ne jeûnent pas de la même façon. Les prescriptions ne sont pas obligatoires, ce n’est pas un aliment ou l’abstention d’un aliment qui nous rapproche de Dieu (cf. 1 Co 8,8) et aucune nourriture n’est considérée comme impure dans la vie ecclésiale (cf. vision de Pierre à Joppé en Ac 10-11).
Quoi qu’il en soit, une chose doit rester constamment présente à notre esprit : notre jeûne, notre aumône, notre pardon, etc. doivent émaner de notre cœur, doivent être des fruits spontanés de notre générosité, non des sacrifices consentis chichement. La joie du fidèle reste un indispensable critère, tant pour le jeûne que pour tous les autres exercices ascétiques (cf. 2 Co 9,6-7).
Carême et joie, carême et Résurrection
Enfin, le carême ne peut s’entendre que dans la joie de la Résurrection. Si nous ne visons pas cet objectif, notre prédication est vaine ; vaine est notre foi (cf. 1 Co 15,13-14). Si nous avons mis notre espérance en Christ 1 Co 15,19. pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
Le jeûne, les efforts ascétiques et la prière nous préparent à vivre la fête suprême de Pâques.
![]() Homélie de Jean Chrysostome Lors de la veillée pascale, on lit traditionnellement un célèbre sermon de saint Jean Chrysostome qui invite tout le monde à se réjouir à la nouvelle de la résurrection du Christ. Nous terminons la présentation du carême par ce texte dont l’actualité transcende les âges.
Homélie de Jean Chrysostome Lors de la veillée pascale, on lit traditionnellement un célèbre sermon de saint Jean Chrysostome qui invite tout le monde à se réjouir à la nouvelle de la résurrection du Christ. Nous terminons la présentation du carême par ce texte dont l’actualité transcende les âges.
Que tout homme pieux et ami de Dieu jouisse de cette belle et lumineuse solennité ! Que tout serviteur fidèle entre avec allégresse dans la joie de son Seigneur ! (Mt 25,21) Celui qui a porté le poids du jeûne, qu’il vienne maintenant toucher son denier. Celui qui a travaillé depuis la première heure, qu’il reçoive aujourd’hui le juste salaire. Celui qui est venu après la troisième heure, qu’il célèbre cette fête dans l’action de grâces. Celui qui est arrivé après la sixième heure, qu’il n’ait aucun doute, il ne sera pas lésé. Si quelqu’un a tardé jusqu’à la neuvième heure, qu’il approche sans hésiter. S’il en est un qui a traîné jusqu’à la onzième heure, qu’il n’ait pas honte de sa tiédeur, car le Maître est généreux, il reçoit le dernier comme le premier ; il accorde le repos à l’ouvrier de la onzième heure comme à celui de la première ; il fait miséricorde à celui-là, et comble celui-ci. Il donne à l’un, il fait grâce à l’autre. (Mt 20,1-16) Il accueille les œuvres et reçoit avec tendresse la bonne volonté ; il honore l’action et loue le bon propos. Ainsi donc, entrez tous dans la joie du Seigneur ! Premiers et derniers, recevez la récompense. Riches et pauvres, chantez en cœur tous ensemble. Les vigilants comme les nonchalants, honorez ce jour. Vous qui avez jeûné, et vous qui n’avez pas jeûné, réjouissez-vous aujourd’hui. La table est préparée, mangez-en tous ; (Mt 22,4) le veau gras est servi, que nul ne s’en retourne à jeun. (Lc 15,23) Jouissez tous du banquet de la foi, au trésor de la bonté. Que nul ne déplore sa pauvreté, car le Royaume est apparu pour tous. Que nul ne se lamente de ses fautes, car le pardon a jailli du tombeau. Que nul ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous en a libérés. Il a détruit la mort, celui que la mort avait étreint ; il a dépouillé l’enfer, celui qui est descendu aux enfers. Il a rempli l’enfer d’amertume, pour avoir goûté de sa chair. Isaïe l’avait prédit en disant : « L’enfer fut rempli d’amertume lorsqu’il t’a rencontré » (Is 14,9). L’enfer est rempli d’amertume, car il a été joué ; bouleversé, car il a été enchaîné ; bouleversé, car il a été mis à mort ; bouleversé, car il a été anéanti ; consterné, car il a saisi un corps et s’est trouvé devant Dieu. Il a pris la terre et a rencontré le ciel ; il a saisi ce qu’il voyait, et il est tombé sur celui qu’il ne voyait pas. Ô mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? (1 Co 15,55)
Pour approfondir le sens du carême :
O. Clément et A. Schmemann, Le mystère pascal, Bellefontaine, 1975.
Collectif, Dieu est vivant (Catéchèse orthodoxe), Paris, Cerf, 1979, (chapitres correspondants).
Crédit : Christophe d’Aloisio, Point KT