Psaumes interdits – Du silence à la violence de Dieu
 Les Psaumes, si fréquemment priés, ne sont-ils pas tous destinés à nourrir la foi ? Or, fort curieusement, il s’en trouve parmi eux quelques-uns qui ont de quoi nous embarrasser, nous faire sursauter même.
Les Psaumes, si fréquemment priés, ne sont-ils pas tous destinés à nourrir la foi ? Or, fort curieusement, il s’en trouve parmi eux quelques-uns qui ont de quoi nous embarrasser, nous faire sursauter même.
Ce sont les prières désespérées de croyants qui ont l’impression que Dieu ne répond pas. Ce sont aussi, plus choquants encore, les appels qui pressent Dieu … Lire la suite

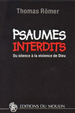

 L’Ancien Testament ne « mâche » pas ses mots et encore moins ses images. Dieu possède une bouche et n’est nullement muet ; Dieu a un bras et une main qui agissent dans l’histoire du salut de son peuple ; Dieu ouvre ses yeux qui regardent au cœur ; Dieu a des oreilles qui entendent les supplications et l’oppression de …
L’Ancien Testament ne « mâche » pas ses mots et encore moins ses images. Dieu possède une bouche et n’est nullement muet ; Dieu a un bras et une main qui agissent dans l’histoire du salut de son peuple ; Dieu ouvre ses yeux qui regardent au cœur ; Dieu a des oreilles qui entendent les supplications et l’oppression de … 
 Nous avons retenu un certain nombre d’extraits de psaumes, arrangés pour être lus de manière antiphonée. Ils soulignent telle ou telle dimension du thème. Certains textes font peut-être double emploi, ils élargissent le choix possible. Ces textes peuvent introduire ou terminer une séance. Avec les chants, ils permettront aux enfants d’exprimer en les célébrant, les découvertes faites dans les récits. …
Nous avons retenu un certain nombre d’extraits de psaumes, arrangés pour être lus de manière antiphonée. Ils soulignent telle ou telle dimension du thème. Certains textes font peut-être double emploi, ils élargissent le choix possible. Ces textes peuvent introduire ou terminer une séance. Avec les chants, ils permettront aux enfants d’exprimer en les célébrant, les découvertes faites dans les récits. … 