Du tohu bohu à la coccinelle module 2 : La lumière
 La lumière est une bonne chose ! Dieu dit « Je veux que la lumière brille ». Et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l’obscurité. Dieu appelle la lumière « jour » et l’obscurité, il l’appelle « nuit ». Il y a un soir, il … Lire la suite
La lumière est une bonne chose ! Dieu dit « Je veux que la lumière brille ». Et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l’obscurité. Dieu appelle la lumière « jour » et l’obscurité, il l’appelle « nuit ». Il y a un soir, il … Lire la suite


 En un siècle, le regard sur les personnes ayant un handicap a profondément changé. On est passé d’un temps où la seule alternative était l’asile, à celui où le concept de maladie a prédominé : on soigne une maladie, une déficience. Plus tard encore, on voit essentiellement une personne à éduquer. Aujourd’hui, on s’achemine vers un concept de citoyenneté qui
En un siècle, le regard sur les personnes ayant un handicap a profondément changé. On est passé d’un temps où la seule alternative était l’asile, à celui où le concept de maladie a prédominé : on soigne une maladie, une déficience. Plus tard encore, on voit essentiellement une personne à éduquer. Aujourd’hui, on s’achemine vers un concept de citoyenneté qui 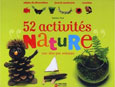
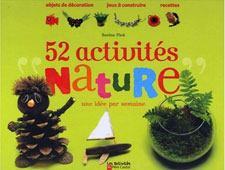 Un livre à emporter pendant les vacances et à utiliser tout au long de l’année ! Il permettra aux enfants de fabriquer de jolis objets de décoration, à garder ou à offrir, des jeux et pour les gourmands du pain d’épices, des madeleines au miel, un clafoutis…
Un livre à emporter pendant les vacances et à utiliser tout au long de l’année ! Il permettra aux enfants de fabriquer de jolis objets de décoration, à garder ou à offrir, des jeux et pour les gourmands du pain d’épices, des madeleines au miel, un clafoutis…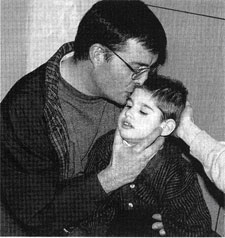


 Qu’est-ce que la sagesse des Écritures peut apporter, concernant l’usage du temps ? Comment répond-t-elle à cette préoccupation permanente de l’homme au cours de l’histoire et plus que jamais véritable enjeu de société aujourd’hui ?
Qu’est-ce que la sagesse des Écritures peut apporter, concernant l’usage du temps ? Comment répond-t-elle à cette préoccupation permanente de l’homme au cours de l’histoire et plus que jamais véritable enjeu de société aujourd’hui ?




 Les symboles, moyens de communication
Les symboles, moyens de communication